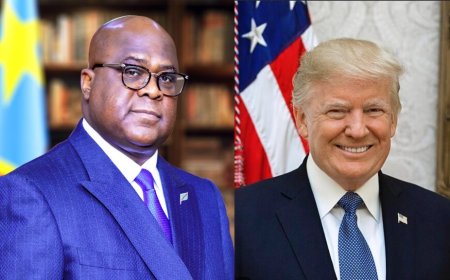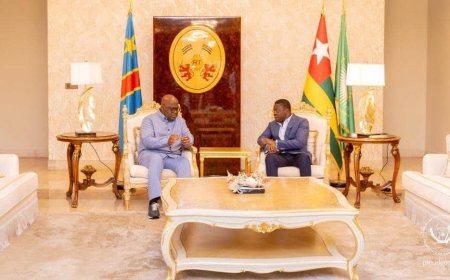Parlement RDC : un bilan qui fait réfléchir

Dans un contexte de guerre persistante à l’Est, l’attente était grande quant à la capacité des députés et sénateurs à réagir avec efficacité. Mais entre débats passionnés, interpellations, propositions de lois et procédures judiciaires inédites, la session a davantage mis en lumière les limites structurelles de l’institution que sa capacité à transformer l’urgence nationale en action concrète.
L’agression rwandaise via le M23 et l’occupation de localités dans le Nord et le Sud-Kivu ont dominé les débats dès l’ouverture de la session. Vital Kamerhe, président de l’Assemblée nationale, a placé la souveraineté et la crise humanitaire au centre de son discours inaugural. Une résolution unanime a condamné l’implication du Rwanda, soutenant la saisine de juridictions internationales telles que la Cour africaine des droits de l’homme et la CPI.
Le Parlement s’est aussi engagé à intensifier sa diplomatie parlementaire, notamment à travers les forums régionaux. Cependant, ces engagements n’ont pas suffi à infléchir la réalité : les violences se poursuivent, les déplacés se multiplient, et aucune mission parlementaire n’a été dépêchée sur le terrain.
Aucune réforme d’envergure sur la gouvernance militaire ou la mobilisation stratégique n’a vu le jour. Fait marquant, le Sénat a levé l’immunité de l’ancien président Joseph Kabila, aujourd’hui sénateur à vie, dans le cadre d’une enquête pour complicité présumée avec le M23. Un geste sans précédent dans l’histoire parlementaire de la RDC, salué comme une rupture avec l’impunité, mais jugé risqué par certains observateurs.
La série Mutamba Matata entre en lice
Constant Mutamba, ministre de la Justice, visé par une enquête pour détournement de fonds liés à la construction d’une prison à Kisangani, le jeune ministre de la justice a presenté sa démission au chef de l'État. Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre, a de nouveau fait l’objet d’une demande de poursuites, cette fois dans le dossier du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Si l’Assemblée n’a pas autorisé les poursuites, la Cour constitutionnelle l’a tout de même condamné à 10 ans de prison. Ces actions traduisent un regain de contrôle parlementaire, tout en soulevant des interrogations sur une possible instrumentalisation politique de la justice à l’approche d’échéances électorales. Malgré un ordre du jour chargé (plus de 35 textes), seuls 9 projets ou propositions de loi ont été adoptés, dont ;
* La loi de finances rectificative 2025, incluant une hausse de 12 % du budget alloué à la défense et aux services de renseignement ;
* La création de l’Agence nationale pour la relance agricole ;
* Une révision technique de la loi électorale ;
* Une loi sur la cybersécurité ;
* Plusieurs ratifications d’accords bilatéraux en matière d’infrastructures et d’éducation.
Des textes cruciaux, comme celui sur la protection des déplacés ou la réforme du commandement militaire, ont été reportés. Plus de douze ministres et directeurs généraux ont été interpellés, notamment :
* Le ministre de la Défense, sur les performances des FARDC ;
* La ministre des Affaires sociales, sur la prise en charge des déplacés ;
* Le ministre des Finances, sur les décaissements destinés aux zones en conflit.
Malgré ces initiatives, aucune motion de censure n’a été déposée. Une motion de recommandation appelant à un audit des dépenses sécuritaires a été adoptée, mais son impact reste limité en l’absence de caractère contraignant. Cette session de mars se voulait celle du sursaut national. Elle a été riche en symboles, notamment avec la levée d’immunités et les résolutions sur la guerre à l’Est, mais peu concluante sur le terrain législatif et sécuritaire.
M.A.M