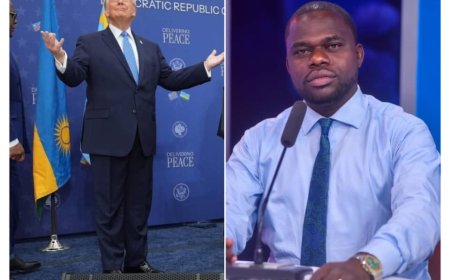Le paradoxe de la souveraineté congolaise : accuser le Rwanda tout en dépendant des médiateurs extérieurs

À chaque crise, le Congo crie sa souveraineté. Tshisekedi le répète : “le Rwanda sabote la paix, le Rwanda appuie le M23, le Rwanda bloque l’avenir de l’Est.” Ces mots résonnent fort… mais que valent-ils, quand dans le même souffle, Kinshasa en appelle aux médiateurs étrangers pour arbitrer son destin ? Par Salem Mapuna, le Politico-Psychologue
Psychologiquement, c’est le syndrome de l’adolescent rebelle : il clame son indépendance, mais ne peut pas se passer de l’autorité du père. Ici, le “père”, ce sont les États-Unis, l’ONU, l’Union africaine. Ils organisent nos dialogues, rédigent nos feuilles de route, imposent nos cessez-le-feu. Alors de quelle souveraineté parle-t-on ?
Politiquement, le paradoxe est brutal : comment un État qui ne maîtrise pas ses frontières, qui délègue sa sécurité à des missions étrangères, peut-il convaincre son peuple qu’il contrôle sa destinée ? Accuser le Rwanda devient une facilité. Mais la vérité est plus dure : le Congo ne souffre pas seulement de l’agression extérieure, il souffre de sa dépendance intérieure.
Le Rwanda, lui, applique une stratégie simple : agir pendant que le Congo négocie. Pendant que nous faisons des conférences, il occupe le terrain. Pendant que nous appelons Washington à l’aide, il avance ses pions. L’un se bat, l’autre quémande. Et dans ce duel psychologique, le plus petit gagne toujours contre le plus grand, parce que le grand ne croit pas en lui-même.
Pour finir, il est temps d’admettre cette vérité inconfortable : la souveraineté ne s’achète pas sur la table des négociations internationales, elle se construit par la discipline, la cohérence et la confiance. Tant que le Congo ne se réappropriera pas son destin, les accusations contre le Rwanda resteront des cris dans le vent.
Salem MAPUNA l'analyste politico-psychologique